| h | ||
     |
||
| Vous ètent ici Accueil >> Histoire >> Les Invasions >> L'Histoire >> Départements >> Il y a 100 ans >> Haspres et le weeb. | ||
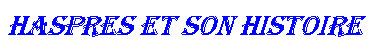 |
 |
|
| h | ||
     |
||
| Vous ètent ici Accueil >> Histoire >> Les Invasions >> L'Histoire >> Départements >> Il y a 100 ans >> Haspres et le weeb. | ||
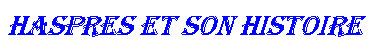 |
 |
|
| Le
Livre "HASPRES et son passé" réalisé
par
Monsieur GUY MORELLE. Copyright by Guy MORELLE Ouvrage édité par l'association : Les amis du Cambrésis 15 rue de l'épée 59400 CAMBRAI Imprimerie Lenglet. Caudry. Dépôt légal. 2ème trimestre 1982. |
| Pour une vue agrandie des photos de cette page, cliquez dessus. |
| LA
RÉVOLUTION. |
Joseph LEBON président du tribunal révolutionnaire de la région |
Haspres à
la veille de la révolution. A la veille de la Révolution, Haspres était déjà un gros bourg de 2079 habitants (Denain n'en avait que 800 et ne s'étendra qu'après la découverte du charbon en 1826). C'était l'un des plus gros villages du Hainaut et ceci était dû à l'essor de sa Prévôté, à sa position privilégiée sur la Selle, à ses ressources naturelles (cultures, exploitation de la craie). Haspres n'avait pas de seigneur. Des historiens mentionnent qu'un seigneur Amand d'Haspres s'illustra lors du célèbre tournoi d'Anchin vers 1090. Il s'agissait en fait d'un chevalier hasprien qui partit aux croisades et en revint couvert de gloire. En 1789, c'était le prévôt, Ambroise Riche qui jouait le rôle de seigneur. Il avait sous ses ordres un bailli, des sous baillis, échevins... Par la charte du XVIIème siècle :"Le prévôt d'Haspres réglait toutes les choses ayant trait à la vie publique du village". (voir la page consacrée à la prévôté). |
|
Nous avons vu dans le chapitre consacré
à la
Prévôté qu'à cette
époque, le droit de cens imposait au paysan une redevance
annuelle en blé et en argent.
Il était astreint de faire moudre son
grain au Moulin des Moines moyennant redevance.
La corvée l'obligeait d'entretenir routes
et chemins. L'impôt
le plus lourd était la
gabelle (impôt sur le sel).
Le droit de bergaigne imposait les enseignes, les
étalages. Le
paysan n'avait ni le droit de chasser, ni le
droit de pêcher,
ni le droit de posséder un pigeonnier.
En cas de conflit, "pour soutenir son honneur et son
église",
le Prévôt d'Haspres avait le droit d'appeler les
hommes du village. Toute
affaire juridique était
réglée sans appel par le
Prévôt. Ecrasé d'impôts, exploité, opprimé, le paysan d'Haspres aspirait à un changement de régime... et ce sera la Révolution. LA PREVOTE ÉTAIT-ELLE DÉJÀ APPELEE A DISPARAÎTRE ? Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'à l'aube de la Révolution, un arrêt du Conseil de Louis XVI daté du 20 décembre 1788 annonçait "le séquestre des biens et des revenus de la Prévôté" . Cet arrêt "annonce la destruction de la Prévôté d'Haspres, dépouille le Prévôt de sa juridiction spirituelle, de son état, de son administration et confie cette administration à un économe-séquestre" (Extrait d'un parchemin). Une supplique du Prévôt, du bailli, du Mayeur, des échevins et habitants d'Haspres fut envoyée au Roi lui demandant d'annuler cette décision 'les supplions osent espérer que Sa Majesté prêtera une oreille favorable à leurs justes remontrances et qu'elle leur accordera la conservation de la Prévôté d'Haspres". Cette supplique envoyée au roi le 1er mars 1789 fut-elle lue du monarque ? Qu'aurait-il décidé ? |
|
|
| UN
SIÈCLE SANS
GUERRE A HASPRES . De la Convention à la première guerre mondiale, de 1794 à 1914, Haspres, éternellement placé sur la route des invasions, ne connaîtra plus de guerre, même sous l'Empire. Néanmoins, notre village sera occupé de 1816 à 1818 par les Russes mais, en 1870, les Prussiens s'arrêteront à Montrécourt et à Iwuy. |
|
HASPRES
SOUS LE PREMIER EMPIRE |
| L'OCCUPATION
RUSSE APRÈS WATERLOO (1816-1818). Au lendemain de Waterloo, Haspres fut momentanément occupé par les Prussiens. Blücher avait établi son quartier général à Maroilles. Quant à Wellington, il avait établi le sien à Cambrai (au musée actuel). Cette occupation dura jusqu'à novembre 1816, date à laquelle l'une des clauses du second traité de Paris mentionnait qu'un corps de 45.000 Russes viendrait, dès les premiers jours de 1816, relever les troupes Prussiennes cantonnées dans le Nord. Leur chef, le général Voroncef Voroncov. fixa son quartier général à Maubeuge, commandant un territoire qui s'étendait approximativement sur le Hainaut, le Cambrésis, l'Avesnois, la Thiérache et les Il fallut alors, comme l'écrit Géry Herbert dans "Jadis en Cambrésis" : "nourrir les troupes, les loger, se plier à toutes les exigences et payer des sommes énormes. C'étaient tous les jours des réquisitions, de voitures, de chevaux, de vaches, de volailles, de boissons ..." A Haspres, les cavaliers russes campaient sur la rive gauche de la Selle, à l'endroit du jardin public actuel, abreuvant leurs chevaux dans le Tiot Rio (on a d'ailleurs donné à cet endroit le nom de "quartier des Hussards"). Le lieu dit "le Parc" serait, d'après certains vieux Haspriens, un endroit ou on parquait le bétail réquisitionné. Il y a quelques années, un commerçant de la rue de Villers trouva dans sa cour des boulets à mèche provenant d'une batterie russe postée sur les remparts. |
| > |
A l'époque, tout chef de
famille qui possédait une maison devait héberger
quelques soldats russes. Aussi les autorités municipales
décidèrent-elles de démolir la tour (ou
donjon) qui se trouvait
à l'entrée
de la prévôté et firent construire,
avec les matériaux,
une caserne (actuel club du
3ème âge)
pour ces occupants. La place de l'église appelée l'Enclos, faisait office de cour de caserne et la petite remise avec ses barreaux garde encore le nom de corps de garde. On retrouve encore dans certains villages du Cambrésis (Honnechy, Bertry) de vieux bâtiments ressemblant à cette caserne et qui hébergèrent également les Russes. |
|
Les soldats russes étaient soumis à une
discipline très sévère.
Le knout (bastonnade publique) punissait les coupables. Un cosaque
ayant volé un jambon dans une ferme de la rue
"derrière les
champs" fut toué de coups par les officiers. "Ces soldats,
dit l'abbé Turquin dans l'histoire de Saulzoir, adoraient le
lard et
se baignaient dans la Selle même en plein hiver". |
|
|
|||
 |
|||
| LA
GUERRE 1914-1918 LES ORIGINES DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE Les origines du premier conflit mondial sont d'ordre moral et économique. Dès 1871, la proclamation de l'Empire Allemand au château de Versailles, la perte de l'Alsace-Lorraine, les milliards versés à l'Allemagne (un train d'or, disaient les vieux Haspriens) avaient été pour les Français patriotes à l'époque, une grande humiliation. Un esprit de revanche était né, esprit de revanche entretenu par le père, par l'instituteur, par le curé, par l'officier ... esprit de revanche qui allait régner 44 ans. Les rivalités commerciales et coloniales, la course aux armements, l'opposition diplomatique entre la Triple Alliance (Allemagne, Autriche, Italie) et la Triple Entente (France, Russie, Royaume-Uni) avaient créé un climat extrêmement tendu. L'assassinat de l'Archiduc héritier d'Autriche à Sarajevo, le 28 juillet 1914, mit le feu aux poudres. Un imbroglio diplomatique se déroula alors en une semaine. Le 1er août, l'Allemagne déclara la guerre à la Russie, le 2 août, la France mobilisa, le 3 août, l'Allemagne déclara la guerre à la France ... les dés étaient joués. LA MOBILISATION A HASPRES Le 2 août, dans l'après-midi, les cloches sonnèrent à toute volée annonçant aux Haspriens la mobilisation générale. Des affiches "bleu blanc rouge" furent collées à la mairie, sur la place, à la gare, sur les édifices municipaux. Les 200 mobilisés sont appelés à rejoindre dans les plus brefs délais les garnisons régionales (Le 127ème R.I. à Valenciennes commandé par le Major Denope qui montera immédiatement au front des Ardennes, le 15ème d'Artillerie à Douai, le 84ème Territorial à Cambrai ... ) A la gare d'Haspres, des trains bondés de mobilisés passaient d'heure en heure. "Fleur au fusil, moral d'acier, espoir en une victoire éclair" annonçaient les journalistes ... tout cela accompagné de chants patriotiques et mêlé aux larmes des mères, des épouses, des enfants ... 73 de ces braves ne reviendront pas. |
|||
L'INVASION D'HASPRES ( 25 août 1914) Le 25 août 1914, au lever du jour, les premiers Allemands de l'armée Von Kluck, venant de Douchy, se glissaient sur la rive gauche de la Selle, empruntant le chemin de Noyelles, et tiraient quelques salves de fusil, d'ailleurs sans éffet, sur l'Aubette. Ils avaient déjà tué, sur le pont de Douchy enjambant la Selle, un Hasprien : François Dagniaux qui jouait le rôle de G.V.C (garde de voie civil). |
|||
> L'entrée des Allemands dans le Nord (fin août 1914) |
Puis,
vers 6 heures, une
section cycliste venant de la route de Denain,
pénétra
dans Haspres et s'arrêta sur la Grand-Place. (les
Haspriens étaient stupéfaits de cette invasion
aussi
rapide et aussi imprévue). Ces Allemands descendirent alors de vélo, se postèrent entre le café Français (café Laure) et la ferme Lestoille et tirèrent quelques salves d'intimidation qui ne firent aucune victime. Ils poursuivirent ensuite leur invasion vers Saulzoir, prenant la route départementale et le Chemin Vert et massacrèrent les Territoriaux de la Mayenne (On appelait à l'époque, territoriaux, les soldats d'âge mûr, formant une armée sédentaire chargée de la défense du territoire). |
||
| Devant la
rapidité de l'invasion, ces territoriaux n'avaient qu'une
ressource : se replier sur les hauteurs de Villers et du
bois de Saulzoir. Courant à découvert, essayant
de se
cacher parmi les gerbes de blé, vêtus d'uniformes
trop
voyants (tréllis blanc-bleu) ils offrirent aux Allemands
cachés dans les talus des cibles idéales.
Trente-cinq
de ces malheureux furent ainsi massacrés. Après la section cycliste, les Uhlans qui depuis l'aube chevauchaient dans la plaine, au Nord du village, firent leur entrée dans Haspres par la route de Valenciennes. Face au cimetière, ils massacrèrent les occupants d'une voiture militaire dans laquelle avait pris place la femme du pâtissier, Augusta Bailly (qu'ils prirent pour une espionne) et une fillette de 5 ans. Certains racontent que les sauvages Uhlans achevèrent la fillette à coups de revolver. Dans l'après-midi de ce 25 août, les officiers allemands craignant des manifestations d'hostilité de la part de la population enfermèrent 17 otages dans les caves de la ferme Numa Lestoille, à titre de représailles préventives. Aucun incident ne s'étant produit, ces, 17 otages furent libérés dans la soirée. LA VIE DES HASPRIENS SOUS L'OCCUPATION ALLEMANDE Il est impossible de décrire la vie des Haspriens sous l'occupation allemande en un seul chapitre. Un livre entier suffirait à peine. Aussi, au risque de paraître incomplet, nous nous bornerons à retracer sommairement quelques passages de cette époque. L'aube du 26 août 1914 se leva sur notre village aux mains des Allemands pour plus de 4 ans. Dès le matin, un chariot alla relever les cadavres des Territoriaux de la Mayenne, qu'on enterra au cimetière dans une fosse commune. (Chaque année, le 11-novembre, les anciens combattants allaient déposer une gerbe sur cette tombe. En 1970, on exhuma les restes de ces malheureux). Et puis, pendant quelques jours, Haspres allait vivre un calme relatif : les Allemands étant avant tout préoccupés par leur course "nach Paris". On pouvait même, chose impensable, rejoindre avec de gros risques la France non occupée en se glissant vers Lille, Lille qui ne sera aux mains des Allemands que le 13 octobre. Mais, quand le flot des armées germaniques fut stoppé sur la Marne et que les Allemands durent se cantonner dans notre village, la Kommandantur allait remplacer l'administration communale, la misère allait régner à Haspres. Des affiches allaient régulièrement couvrir les murs de la Mairie mentionnant les ordres de la Kommandantur. "Sous peine d'amende", "Sous peine d'emprisonnement", "Sous peine de mort" il était interdit : de s'approcher des voies de chemin de fer, de quitter le village sans un laisser passer de la Kommandantur, d'élever des pigeons, de sortir de son domicile après le couvre-feu (en 1917, Georges Crocfert, âgé de 22 ans, se dirigeant un soir dans le chemin de Thiant, dans le but de rapiner quelques pommes de terre, n'entendit pas le sommations de la sentinelle allemande postée sur le pont et fut impitoyablement abattu). Toute personne devait porter sur elle sa carte d'identité et répondre périodiquement à un appel nominatif. Haspres privé de tout trafic devait donc se suffire à lui-même plus d'épicerie, plus de boulangerie, plus de boucherie particulières. Toute l'alimentation était livrée au compte-gouttes au magasin de ravitaillement (boucherie Bécart actuelle). Jules Mousseron, le poète patoisant régional, nous parle du fameux pain livré à la population "Les barbares d'Prussiens, Les brigands, les coquins, In pillards d'origine Ont volé nos farines Pour nous vind'hors dé prix Du pain cope-appétit ... L'croute est dur comm' du cuir Noir' comme del peau d'Kroumir. C'pain lourd comm' du plomb, Pou l'santé n'a rin d'bon, L'peupl' qui l'mingl sans invie A tout's les maladies " Et les Boch's dis'nt sérieusement Qué sans euss's in mourrot d'faim". |
|||
|
|
|||
| L'ARRIVEE DES LIBERATEURS. LES ANGLAIS ET LES CANADIENS A CAMBRAI Après 4 ans de misère, d'attente, d'anxiété, l'espoir revint. Le bruit des canons se rapprochait... Les Allemands étaient nerveux et démoralisés ... On pressentait la fin. Le 27 septembre 1918, la ère Armée Britannique (Horne) et la 3ème Armée (celle qui libèrera Haspres) venant du sud-ouest enlevaient Marcoing. Les Plateaux du Cambraisis furent conquis en quelques jours. Le 30 septembre les Anglais étaient aux lisières de Cambrai. La ville encerclée fut incendiée par les Allemands ... Le Front ennemi craquait de partout et le 9 octobre, à 4 heures du matin, les Canadiens entraient à Cambrai par le nord et les Anglais par le sud (Jonction victorieuse des Armées Horne et Byng). L'EVACUATION. LA LIBERATION D'HASPRES (23 octobre 1918) L'évacuation : Le lendemain, 10 octobre ' la Kommandantur donne aux Haspriens l'ordre d'évacuer. "Par suite de la situation militaire, les habitants des communes du Valenciennois seront évacués pour leur propre sécurité dans des régions plus en arrière. L'évacuation aura lieu le jour après la publication de cet avis. Par manque de moyens de transport, les habitants ne pourront emporter avec eux en fait de nourriture, vêtements et linge, que ce qu'ils peuvent emporter pour une marche assez longue. Il n'y avait plus à Haspres ni voitures, ni chevaux. Le seul moyen de locomotion fut la marche, les seuls moyens de transports furent les poussettes, les brouettes ' les vélos ... Obéissant aux ordres de la Kommandantur, on avait emporté le strict nécessaire, et au bout de 4 jours de débâcle la population Hasprienne se trouva aux environs de Mons (Jemmapes, Sipply, Pâturages) où elle attendit la fin des événements tandis que notre village subissait l'assaut des armées libératrices. Les Cambraisiens qui avaient quitté leur ville quelques jours avant, avaient emmené avec eux leurs géants Martin et Martine qu'ils durent abandonner à Haspres dans une ferme près de la Place. |
|||
 |
|||
| LA LIBÉRATION D' HASPRES (
23 OCTOBRE 1918 ) Après la prise de Cambrai, le 9 octobre 1918, les Britanniques appuyés par les Canadiens eurent pour mission de percer la position Hermann (Bruges, Valenciennes, Escaut, cours de la Selle) sur laquelle s'étaient repliés les Allemands. |
|||
| > La place après le bombardement Anglais (octobre 1918) |
M.
Jean Béra Cacheux, témoin
oculaire (il était parmi les 72 Haspriens qui n'avaient
pas évacué) nous raconte que, du haut de sa
grange, il
avait vu se dérouler les opérations : " du 11 au
23 octobre dit-il, Haspres allais subir un bombardement
intensif et régulier. Chaque jour, dès 7 heures
du
matin, les batteries anglaises postées sur les hauteurs
de Cambrai pilonnaient notre village détruisant surtout
les quartiers limités par la rive droite de la Selle et
la route de Valenciennes. Puis, les Anglais, par nuées, descendaient des hauteurs de Villers, du bois de Saulzoir, du bois Bouquette, vers le village. Mais des mitrailleurs allemands postés et protégés à l'ouest par le talus du long Boyau et à l'est par une haie longeant la pâture Herbin massacrèrent les Britanniques qui avançaient à découvert". |
||
|
Il
est impossible d'évaluer le nombre exact des victimes car
des
brancardiers relevaient les cadavres et les ramenaient vers
l'arrière. Sur le monument aux morts, on peut lire les noms
de ces
braves dont 147 reposent au cimetière du chemin de Cambrai
et 64 à
celui de la route de Villers. On peut affirmer que plusieurs centaines
furent tués sur le territoire hasprien. Le 23 octobre 1918, au matin, les canons anglais cessèrent de bombarder le village. La ligne Hermann craquait de tout côtés. Les Allemands en déroute après avoir dynamité la gare faisaient sauter les rails de la ligne de chemin de fer et refluaient vers l'Écaillons. Vers 12 heures, les premiers Anglais de la 3ème Armée britannique commandée par Bying, venant du Moulin Bulté, entraient à Haspres. Notre village était libéré après 1551 jours d'occupation allemande. Les Anglais, ayant forcé le passage de la Selle, le 23 octobre 1918, avancèrent à la fois vers Avesnes et Valenciennes. L'Athènes du Nord fut libérée le 2 novembre, à 7h30, par les armées françaises, anglaises, canadiennes qui s'emparèrent alors de toutes les positions de la ligne Hermann. Le 10 novembre 1918, les Haspriens évacués aux environs de Mons virent arriver leurs libérateurs. L'ennemi avait déjà demandé l'arrêt des hostilités. Les plénipotentiaires allemands avaient franchi la frontière à La Capelle pour se rendre à Compiègne où l'armistice sera signé le 11 novembre. Le cauchemar prenait fin. Dès leur libération, les évacués haspriens revinrent de Belgique et retrouvèrent un village bien détruit. Bien vite, les nouvelles arrivèrent. Les soldats français dont le village avait été libéré eurent droit à 3 jours de permission. Aussi vit-on revenir Georges Delhay, Henri Chatelin, Paul Bulté,... après 4 ans et 3 mois de séparation anxieuse. Emouvantes retrouvailles troublées par les mauvaises nouvelles : 73 d'entre eux étaient morts sur les champs de bataille. Et puis, Haspres se releva lentement de ses ruines. Les jeunes gens, les cultivateurs (avec ce qui leur restait de matériel), quelques prisonniers allemands sous la surveillance de gardiens furent affectés aux T.P.U. (travaux de première urgence). On reboucha les trous d'obus, on désamorça les munitions, on déblaya les maisons démolies... Les artisans effectuèrent leurs premiers travaux aux écoles, à la Mairie... Dès l'établissement des dommages de guerre. Les premières reconstructions eurent lieu au printemps 1919, les "poilus" commencèrent à revenir. Haspres avait vécu sa dernière guerre. Sa "der des der"... Tout au moins le croyait-on. L'avenir allait prouver le contraire. Victimes Civiles : 1914, Bailly Augusta. Noisette Marcelle. Pamart Jules. 1917, Crofer Georges, 1918, Hisbergues Marie, Delcroix Marie, Delcroix Florine, Gossuin Catherine, Pierronne Alfred. |
|||
| Victimes
Militaires : Lesavre Charles Louis Dagniaux François Delmotte Jean-Baptiste Delhaye Georges Mercier Victor Dubus Emile Delmotte Désiré Lesavre Lucien Morelle Alphonse Gosse Emile Forget Alphonse Boucly Xavier Drancourt Alphonse Dulompont Charles Renaut Lucien Flahaut Charles Leclerc Emile Lepan Louis Colin François Vandeville Joseph Breucq Désiré Morelle Noël Moreau Gustave Béra Numa Lemaire Léon Alaoucherie François Vérin Charles Cossart Georges Mercier Jules Morelle Alphonse Bourlet Achille Charlet Ernest Couet Jean-Baptiste Desvignes Henri Cogniaux Louis Baudoux Jules Béra Edmond |
1914 Dhainaut Alphonse Taisne Edmond Dhainaut Charles Moreau Augustin Marouzé Joseph Dupas Abel Tordoir Maurice 1915 Moreau Arthur Dufour Emile Colin Henri Tahon Charles Bézy Joseph Tahon Lucien Fassiaux Virgile Leduc Charles Coupez Edmond Mercier Victor 1916 Garez Jean Baptiste Charles Jean Baptiste Lemoine Alexandre Duboisdendien André Noisette Jules Saccazin Andolosia Telle Alexandre Tahon Henri Dufour Louis Dozières Lucien 1917 Havez Albert Perlier Numa Leclerc Ernest 1918 Telle François Taisne Maurice Boucly Joseph Gourdin Désiré Béra Jules Morelle Désiré |
||
| C'est au cours de cette guerre, qu'un directeur d'école d'Haspres (1929 1933), devint un as de l'aviation française et obtint de nombreuses distinctions. Monsieur Robert Flament. | |||
 |
|||
|
ENTRE
LES DEUX GUERRE |
|||
|
La
plus belle fête d'après-guerre placée
sous le patronage de : - Proposition de la S.E.R.V.A. (Société électrique de la région de Valenciennes et d'Anzin), de fournir l'électricité au village. - Inquiétude au sujet du dossier de construction de l'école des garçons .1924. - Construction du presbytère où logera l'abbé Bonnet. - Le nouvel abreuvoir est construit. - L'entreprise Tonnoir pose la première pierre de l'école des garçons. - Les deux ponts enjambant la Selle sont achevés. - M. Carpentier est nommé directeur de l'école des garçons en remplacement .1 925. - Creusement d'aqueducs rue de Fleury et rue V. Hugo. - INAUGURATION DE L'ECOLE DES GARCONS. (Ecole Jules Ferry) le 2 août sous la présidence de : M. Lachaze sous-préfet de Valenciennes, M. Jean-Baptiste Mazouré, maire, MM. les Conseillers Municipaux, M. Tonnoir Emile, entrepreneur, - Crise du logement. .1926. - Le montant des travaux de la construction de l'école des garçons s'élevant à 145-000 francs, le Conseil Municipal émet un emprunt de 100.000 francs en 29 ans (soit 8.750 francs par an). - La vitesse des automobiles traversant le village est portée à 20 km à l'heure. - Création d'un champ de tir au chemin de Cambrai. - Remise en état des vitraux de l'église. .De 1927 à 1930. - Construction de douches à l'école des garçons. - M. Blin est nommé directeur de l'école en remplacement de M. Carpentier. - L'abbé Bonnet quitte le village et est remplacé par l'abbé Leclercq. - Les baraquements du Rempart construits par la commune après guerre. sont vendus aux locataires. - M. Cacheux cède sa baguette de Chef de Musique à M. Delforge. - Pavage de la rue de la gare. - M. Flamant, grand-père de notre pharmacien, est nommé directeur d'école en remplacement de M. Blin (octobre 1929). - Agrandissement du cimetière. - Plantation de platanes dans la cour de l'église. - Inondation du village en novembre 1930. .1931. - Erection d'un petit monument aux morts au cimetière. - Projet de remplacement du pont de bois (Rue Gambetta, Général André) par un pont pavé à tablier de fer. - Electrification du Hameau de Fleury. - Fête du cinquantenaire de l'école laïque. - L'abbé Leclercq est remplacé par l'abbé Dassonville. - Début de la crise du chômage (Les chômeurs sont employés à divers travaux communaux). .1932. - Acquisition de terrains (échange ou expropriation) rue Jules Ferry en vue de la construction d'une école maternelle. - Création d'un terrain de football à l'Obette. - Le premier pipe-line transportant le gaz d'Anzin à Cambrai traverse le village. - M. Duverger laisse à la S.E.R.V.A. la concession de l'éclairage électrique à Haspres. - Le pont de bois est remplacé par un pont pavé à tablier de fer avec deux passerelles. - Création d'une 4ème classe aux écoles de garçons et de filles. - Le chômage ne cessera de progresser jusqu'à la guerre. - M. Carpentier est nommé directeur de l'école des garçons en remplacement de M. Flamant. .1933. - La Société Eau et Force propose d'alimenter le village en eau potable. Coût : 1.300-000 francs dont 400-000 francs payés par la société. Après subventions diverses, la commune ne serait redevable que de la somme de .1934-1935. - La Fanfare Municipale remporte merveilleusement le Festival de Melun. Retour triomphal. Réception ... (voir chapitre "La Fanfare d'Haspres"). - La loi Loucheur facilite la construction de nombreuses maisons au Marais. - La route Haspres Monchaux est cimentée. Un violent orage endommage les travaux. .1936. - Année du Front Populaire. Aux élections municipales du 17 mai, le maire socialiste Jean-Baptiste Mazouré garde son siège et 8 communistes entrent au Conseil. - Les congés payés permettent aux ouvriers haspriens de partir en vacances. - Inauguration de l'école maternelle, le 13 septembre, sous la présidence de M. Gaubert, sous-préfet de Valenciennes, - Grèves dans les usines de la région, aux Etablissements Béra ... - La scolarité est portée à 14 ans. .1937-1938. - Construction de l'îlot de l'Aubette (Loi Loucheur). - Inauguration du Stade Léo Lagrange. - La gare appartient désormais à la S.N.C.F. - La prolongation de la scolarité nécessite la création d'une nouvelle classe à l'école des garçons. - M. Webster est nommé directeur d'école et gardera son poste 23 ans. - Munich inquiète les Haspriens. .1939. - La guerre. |
|||
 |
|||
| LA
GUERRE 1939-1945 LA DÉCLARATION DE LA GUERRE : LA MOBILISATION. La guerre commença le dimanche 3 septembre 1939, un beau dimanche d'été, un jour d'ouverture de chasse. On allait hélas remiser les calibres 12 et 16 pour prendre d'autres fusils. On avait cru longtemps que la Guerre 14-18 serait la "der des der". La Conférence de la paix, le Traité de Versailles, la Société des Nations ne furent que de vains espoirs. Il serait trop long de s'attarder sur les causes du conflit la mollesse des démocraties occidentales affirment les uns, une guerre impérialiste voulue par le capitalisme international prétendent les autres. L'avènement de Hitler en 1933, la réoccupation de la Rhénanie en 1936, l'Anschluss (annexion de l'Autriche en 1938), puis Munich (une paix pour 1000 ans dira Chamberlain), enfin l'occupation de la Tchécoslovaquie et l'invasion le 1er septembre 1939 de la Pologne sans déclaration de guerre provoquèrent la riposte anglo-française. La mobilisation fut immédiate. Tous les Haspriens en âge de porter les armes sont appelés dans la région nord de la France. Le 16lème R.A.P. et le 117ème H.T.P. à Valenciennes, le 18ème Territorial à Cambrai, le 101 R.A.L. et le 15ème R.A.D. à Douai, le 412ème R. Pionnier à Arras, le 225ème R.A. et le 27ème R.A. à Hesdun, le train auto à Lille, le 40lème R. Pionnier à Béthune ... accueillirent les 250 mobilisés de notre village. Ceux de 1914 étaient partis la fleur au fusil pour "une guerre rapide" qui allait durer 4 ans. Un million et demi n'en revinrent pas. Beaucoup de mobilisés parmi lesquels des orphelins de la Grande Guerre ne l'oublient pas et c'est en pensant aux 73 Haspriens tués en 14-18 que nos futurs soldats quittent le village. Certains s'attendent à un second Charleroi. En 1914 Haspres fut envahi après 23 jours de guerre, il le sera en 1940 après 8 mois d'hostilités. (hostilités si l'on peut dire). Et ce sera pendant ces 8 mois "la drôle de guerre" : Les soldats végètent", dit Arthur Comte, "dans une inaction totale : au lieu de suivre des entraînements intensifs, c'est à qui les amusera avec le théâtre aux armées, le colis aux armées, le sport aux armées". De nombreux soldats Haspriens auront le privilège de n'être pas trop éloignés de leur foyer et bénéficieront de "perm" du "Noël en famille, de "Pâques en famille" ... et comme le disait la chanson :"Tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas" Maurice Chevalier prétend qu' "on ira pendr'not' linge sur la ligne Siegfried" ... On ira ... peut-être ? Quant au Canard Enchaîné il souligne que le trouffion français s'intéresse plus à la ligne de sa femme qu'à la ligne Maginot. Seuls les aviateurs ne chôment pas. Dès septembre 1939, des combats réguliers opposent Curtiss français et Messerschmitts allemands, Moranes à cocarde et Heinkels à croix gammée. Un avion allemand sera abattu, au dessus d'Haspres et s'écrasera près du bois de Lieu Saint Amand. Ce sera le premier fait de guerre au village. |
|||
| L' INVASION
ALLEMANDE. A la "drôle de guerre" va succéder la "guerre éclair". Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit la Hollande, la Belgique, le Luxembourg. Valenciennes subit ses premiers bombardements. On relève les premiers morts à la Pyramide Dampierre et à la plaine de Mons. Quelques avions à croix gammée passent au dessus d'Haspres. Le 15 et le 16 mai, la première armée doit se replier sur le canal de Charleroi et la frontière. Les civils Belges fuient devant l'envahisseur et des colonnes de voitures déferlent dans Haspres et se dirigent vers le sud. C'est la débâcle Belge : débâcle qui sera la notre dans 48 heures. Le 17 mai, un avion allemand répondant à une rafale de mitrailleuse tirée des pâtures Bourlet bombarde le Marais. Plusieurs maisons sont détruites ou endommagées. Léon Journet aura les deux jambes brisées et devra subir une amputation quelques jours après. Ce sera la première victime hasprienne de la seconde guerre mondiale. A la poussée nord-est allemande va se joindre la manoeuvre d'encerclement du nord de la France qui sera la stratégie des généraux ennemis. Le 16 mai au matin, Rommel à la tête de la VIIème Panzer franchit la frontière au Nord de l'Helpe Majeure et atteint Avesnes le soir même. Le 17 mai, il prendra Landrecies et le lendemain 18 mai Cambrai incendiée sera aux mains des Allemands. (Ce jour là, le forgeron d'Haspres, François Marchant trouvera une mort glorieuse à Bohain). Une partie des troupes ennemies, commandée par Gudérian poursuivra la manoeuvre d'encerclement. Péronne sera atteint le soir de ce 18 mai. Amiens écrasée sous les bombes sera occupée le 20 mai à 9 heures et à 20 heures, les Allemands atteindront la mer à Noyelles sur mer. La nasse était refermée ... Les armées françaises et anglaises prises dans cet étau n'ont plus qu'une ressource : rejoindre la mer du Nord avec l'espoir de s'embarquer pour l'Angleterre. Le 20 mai, un violent combat oppose à Haspres les chars allemands à quelques chars légers français appuyés par le 74ème Régiment d'Artillerie. Les Français firent preuve d'un courage magnifique. La citation du Général Huntzinger en témoigne : "magnifique régiment qui, sous le commandement du Lieutenant-Colonel de Margerittes a brillamment rempli, au cours de la campagne Belgique-France toutes les missions qui lui ont été confiées. Le 20 mai 1940 à Haspres, a contenu plusieurs heures, en mission anti-chars une attaque ennemie menée par des chars lourds" (document transmis par Pierre Lasselin). L'héroïsme de ces soldats n'a pas été oublié et au camp d'Ailleret près de Belfort, un des chars Pluton a été baptisé "Haspres". La supériorité numérique et de l'armement des Allemands décidera de l'issue du combat. De nombreux soldats français durent se rendre et furent faits prisonniers. On citera parmi eux : Stefan Kovacs, entraîneur de l'équipe de football de Roumanie, ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui est revenu à Haspres voici quelques années, visiter les lieux où il fut momentanément emprisonné (ferme Buisset). |
|||
|
LA
DEBACLE (l'évacuation) L'ARMISTICE. LE RETOUR DE L'EVACUATION. L'ATTENTE DES NOUVELLES |
|||
L'OCCUPATION D'HASPRES PAR LES ALLEMANDS. Dès le printemps 1941, notre village fut occupé par la formation allemande Dienstelle Feldspost n287 45. La troupe logeait au patronage, chez le Docteur Pruvost, chez Leleu, dans les granges... Le bureau (mini-kommandantur) siégeait chez Breucq et la demeure d'Édouard l'Eveugle faisait office d'infirmerie. Les officiers logeaient chez l'habitant. Chaque maison bourgeoise devait héberger un Karl, un Hans, un Wolfgang... qui étaient dans l'ensemble assez corrects. Le terrain de football, le "chaufour", les chemins vicinaux étaient transformés en champ de tir et d'exercice. Nous étions étonnés de la sévérité des officiers allemands envers leurs soldats. Une nuit, le couvre-feu fut obligatoire à 20 heures et les Allemands se livrèrent à un simulacre de prise d'assaut du village. Certains d'entre eux durent franchir la Selle à la nage. Le dimanche de Pâques (14 avril 1941) un incident faillit coûter la vie au maire d'Haspres J.B. Marouzé. Pendant que les Allemands festoyaient au Patronage, un adolescent vola un revolver oublié par un soldat dans la maison Vérin. Le maire fut arrêté et resta toute l'après-midi et une partie de la soirée sous la surveillance de 2 sentinelles. L'arme fut retrouvée le lendemain dans le tonneau à eau de pluie du moulin des moines. C'est à cette époque qu'Edmond Crocfer (dont le frère fut tué par les Allemands en 1917) fut arrêté et tué à Loos par la Gestapo dans des circonstances vraisemblablement odieuses. Les Allemands quittèrent Haspres le dimanche 22 mai 1941, le dimanche de l'ascension qui aurait dû être un jour de ducasse. Un mois après ils entraient en Russie. D'après certains témoignages recueillis par des soldats français en occupation, ils périrent presque tous dans les neiges de Moscou et de Stalingrad. Haspres eut encore la visite assez courte des Allemands en février 1944. Il s'agissait cette fois de l'unité Dienstelle 16 309 qui revenait de russie. Elle était commandée par un officier "balafré", très autoritaire, un "sale" Prussien disaient les vieux qui avaient connu ceux de 1914. Enfin, à quelques jours de la libération (fin août 1944) notre village eut la dernière visite des Allemands avant leur grand départ. |
|||