|
|
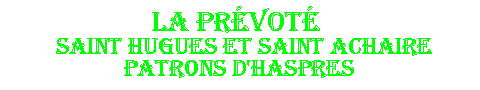 |
 |
| H |
| Vous ètent ici : Accueil >> Culture >> Patrimoine . |
| St Hugues, le Rattachement, Les Bâtiments, Rôle du Prévôt, S/La Révolution, Les Lestoille, Les Prévôts. |
| Pour une vue agrandie des photos de cette page, cliquez dessus. |
| ORIGINES DE LA PREVOTE : |
| SAINT HUGUES ET SAINT ACHAIRE PATRONS D'HASPRES : |
|
Élevé pieusement par un moine du nom de Amfroy,
il entra à 18 ans au monastère de Saint-Jouin et
fut de là envoyé à Jumièges
et placé sous l'autorité de Saint Filbert (ou
Philibert) qui lui donna, vu sa piété, la charge
du monastère de Quayçay. Puis, il revint
à Jumièges dont il deviendra l'abbé.
Il y mourut en l'an de grâce 687. La châsse
contenant ses reliques fut comme celle de Saint Hugues,
amenée à Haspres lors des invasions normandes. Lorsque vers 876, les normands envahirent notre région, les châsses furent mises en sécurité au Château-fort de Douai. Puis, devant le danger des pillards d'Hastings, les moines d'Haspres se rendirent dans le centre de la France, emportant avec eux les précieuses reliques. De retour dans le Nord, ils confièrent un moment leurs châsses aux religieux de Saint-Omer, puis les ramenèrent à Haspres. En 911, Rollon, chef des Normands, imposa au roi de France, Charles le Simple, le traité de Saint-Clair sur Epte. Les Vikings occupèrent la Normandie. La paix revenue, l'Abbaye de Jumièges est rebâtie et les Religieux réclamèrent les reliques de Saint Hugues et de Saint Achaire. Soutenus par l'évêque de Cambrai, par le Prévôt, par le prieur, les moines d'Haspres refusèrent catégoriquement de restituer les précieuses châsses. Saint Hugues et Saint Achaire allaient devenir les Saints Patrons de notre village. Ces reliques allaient dès lors être l'objet d'une grande vénération. "Elle guérissent du mal qui rend les hommes furieux : les acariâtres". Pendant des siècles, de nombreux pèlerinages eurent lieu à Haspres où "on allait servir les reliques quand le cerveau était blessé". Lorsque le roi de France Charles VI devint fou en 1392, on envoya à Haspres une statue du malheureux monarque. Et depuis longtemps, les saintes reliques sont sorties chaque année le jour de l'Ascension, suivies d'une foule de fidèles venues parfois de très loin. |
| |
| LA PREVOTE EST RATTACHÉE A L'ABBAYE DE SAINT-VAAST D'ARRAS. |
|
La ville d'Haspres se trouvait autrefois limitée par la
Selle et par un bras de cette rivière formant une sorte
d'île, un petit Lutèce. Le bras de cette
rivière n'est pas naturel. Ce sont vraisemblablement les
moines de la prévôté qui l'ont
creusé. Des murailles, en grande partie
détruites, entouraient cette île artificielle. On
peut encore admirer certaines d'entre elles avec leur assise en
grès et le mur en briques percé par endroit de
meurtrières. La Prévôté
proprement dite occupait la moitié de l'île.
"Lorsque, en 1024, cette Prévôté fut
cédée à l'abbaye de Saint-Vaast
d'Arras par celle de Jumièges, l'abbé Leduin
travailla à l'embellir d'un cloître
régulier et de nouveaux édifices" (
Jurénil ). Une énorme tour de défense
fut bâtie à l'entrée. Elle sera
détruite en 1816 pour construire une caserne ( actuel salle
du temps libre ) afin de loger les soldats russes en
occupation. L'église ou chapelle des religieux,
fut flanquée de deux tours dont l'une,
transformée plus tard en clocher dominera le village
jusqu'en 1876. Une autre tour dite la tour Baccus, fut bâtie
par la suite pour défendre le passage sur le bras de la
Selle près du pont du Tordoir. On ignore par contre ce qu'étaient les bâtiments où logeaient les moines. On peut se demander s'il ne s'agissait pas de bâtisses en bois étant donné qu'elles étaient régulièrement brûlées ( Vers 880, les Normand ont incendié le Prévôté. Pendant la guerre de Cent ans, en 1350, le Duc de Normandie incendia tout le village. La Hire, compagnon de Jeanne d'Arc en fit de même en 1433. En 1451, le Duc de Vendôme envoyé par François Ier, transforma Haspres et sa Prévôté en un immense brasier que les soldats de Henri II rallumèrent......). |
|
Un pont-levis dont une élévation de terrain
confirme encore
l'existence, enjambait le bras de la Selle et reliait le
monastère à
un immense terrain connu de nos jours sous le nom de "Pré".
Sur le plan de 1619, on observe de nombreuses allées se
rejoignant au
centre de ce terrain, le tout formant vraisemblablement la promenade
des
religieux nécessaire à leurs
méditations. Un fossé partant du pont
Boulanger actuel et qu'on a comblé voici quelques
années longeait
cette promenade et jouait le rôle de seconde
défense artificielle de
la ville. De l'autre côté de la Selle, se trouvait un moulin qui existe encore de nos jours et auquel on a donné le nom de "moulin des moines". Il fut exploité lors de la construction de la Prévôté par un nommé La Warde. Les de Lestoille l'exploitèrent par la suite et ce fut un Lagrue qui en devint acquéreur en 1791. On se demande pourquoi ce bâtiment ne figure pas dans la liste des biens de la Prévôté vendus en 1793 comme biens Nationaux. Une vieille pierre sculptée porte l'inscription suivante : DOM FR (illisible) PRÉVÔT DE CESTE VILLE A FAIT RÉPARER LE MOULIN 1663. ( Il s'agit sans doute de Dom François Doucet Prévôt d'Haspres de 1648 à 1668 ). |
|
Autrefois, il n'y avait à Haspres ni château, ni
seigneur. La Prévôté faisait office de
château avec ses bâtiments, ses fossés,
ses murailles, ses tours et le Prévôt jouait le
rôle de seigneur. Les habitants du village dépendaient en grande partie de la Prévôté. "Les hommes de travail", dit Jurénil, "étaient soumis aux religieux de l'Abbaye". Ils étaient avant tout paysans et exploitaient les terres appartenant au monastère ( il existe encore un lieu-dit : "Le champ de l'Abbaye" ) ainsi que les moulins, fours à chaux, carrière... En plus de leur rôle religieux et de leur rôle d'exploitants, les moines soulageaient les gens du village. ( De nos jours, certains critiques qualifieraient cela de paternalisme ). L'abbé Pontois écrit dans un certificat daté du 28 janvier 1789 : "Les indigents trouvent de grand secours chez les moines. Ceux-ci distribuent toutes les semaines du pain, de la bière et de l'argent à un grand nombre de pauvres; ils ont un soin particulier des malades, leurs fournissant les choses nécessaires pendant leur maladie et leur convalescence. Ils sont les soutiens des veuves et des orphelins; ils concourent à la réfection des maisons défectueuses et en bâtissent tous les ans pour les indigents. En hiver, ils distribuent du charbon; ils fournissent chemises, draps et habillement à ceux qui en ont besoin. En un mot, leurs aumônes sont considérables". Le prévôt nommé par l'abbé de Saint-Vaast d'Arras régnait sur le village. Il dépendait également du Comte du Hainaut ( souvent nommé Baudouin ). Il avait un rôle administratif capital, servant d'intermédiaire entre l'abbé de Saint-Vaast d'Arras ou le Comte du Hainaut et ses administrés. A la veille de la révolution, il rédigea les cahiers de doléances et chargea le bailli d'Haspres qu'on appelait parfois Prévôt le Comte ou Lieutenant-Général, de réunir à Bouchain les députés des principales paroisses. Il jouait également le rôle de juge. Il avait, stipule la Charte de 1176, toute juridiction dans la ville d'Haspres. Il réglait les différents entre les gens du village ( Les injures et querelles allaient jusqu'à entraîner une amande de 60 sols ). En 1630, il fit prendre l'assassin du bailli d'Haspres. Certains jugements de l'émissaire du Comte du Hainaut ne pouvaient être rendus sans son autorisation. Si le Comte du Hainaut voulait enrôler des hommes d'armes, il devait d'abord s'en référer au Prévôt. Il vérifiait les poids et mesures. Il était le percepteur de l'époque. Un tiers des impôts qu'il levait étaient remis à l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras ( le montant des impôts atteignait 40.000 livres en 1788 ). Tout puissant, le Prévôt d'Haspres était en fait le Seigneur du village. |
|
Le départ des moines. On sait peu de choses sur ce que sont devenus les moines sous la Révolution. Aux Archives Départementales, aux bibliothèques régionales, rien n'est mentionné sur leur départ. Lorsque les ecclésiastiques qui n'avaient pas prêté serment à la constitution civile du clergé furent considérés comme suspects, ils prirent dès 1792, le chemin de l'exil. C'est vraisemblablement ce que firent les moines afin d'éviter la guillotine. Aucun d'entre eux ne figure sur la liste des religieux exécutés sur l'ordre de Joseph Lebon. Certains vieux Haspriens ont entendu leurs grands-parents dire que leurs aïeux parlaient souvent du départ des moines... de gros chariots tirés par des boeufs... chariots trop lourdement chargés obligeant les religieux à enterrer une partie des trésors qu'ils emportaient... Vérité relative ? Légende ? Comment les reliques de Saint Hugues et Saint Achaire sont-elles revenues ( ou restées ) à Haspres ? Le départ des moines reste un "trou" dans l'histoire de la Prévôté. On connaît néanmoins le nom des douze derniers bénédictins Dom Odon Bouzez, Dom Pierre Roussel, Dom J. Lebeau, Dom C. Dubois, Dom A. Delavigne, Dom A. Dantrebecq, Dom H. Dubois, Dom A. Bridelarde, Dom Van Outshorn, Dom Jean Sohiez, Dom Ph. Grouillard, Dom H. Grendal. Avec Ambroise Riche s'éteindra la lignée des Prévôts qui gouvernèrent la ville d'Haspres pendant des siècles. Qu'est devenue la fortune des moines ? Origine : A la veille de la révolution, les grands propriétaires terriens étaient les ecclésiastiques et les nobles. Dans le district du Valenciennois, c'était à Haspres que le Clergé avait le pourcentage le plus important des propriétés. L'historien Georges Lefebvre dans son livre "Les paysans du Nord pendant la révolution" mentionne qu'en 1788 les membres du clergé Haspriens possédaient plus de 2000 mencaudées de terres, représentant approximativement 680 hectares, 70% du territoire qu'ont peut évaluer de nos jours (toujours approximativement) à 1300 millions d'anciens francs. D'où provenait cette fortune ? Du travail des moines certes; le succès de l'agriculture médiévale était imputé au labeur des religieux. Si le défrichement n'est pas leur oeuvre exclusive leur rôle fut sans doute considérable. Il faut aussi avouer qu'ils employaient de la main-d'oeuvre à "bon marché". Historia dans un numéro récent mentionne que le salarié agricole touchait 18 sous par jours, l'équivalent d'un kilo de porc. Les moines bénéficiaient en outre de donations que les fidèles, par piété ou crainte de l'enfer, leur légaient. |
La vente des terres des moines : En novembre 1789, afin d'éviter la banqueroute, les députés décidèrent la saisie et la vente des biens du clergé, décrétés Biens Nationaux. Ce fut au district de Valenciennes qu'eut lieu la vente des terres des moines d'Haspres. Il y eut, selon l'historien Georges Lefebvre plus de 400 acquéreurs dont une majorité de paysans. ceux-ci exploitaient, en fait, une petite ferme... insuffisant pour vivre décemment. Aussi étaient-ils également commerçants (cabaretiers, boutiquiers...), artisans (charrons, bourreliers, cordonniers...) et beaucoup d'entre eux mulquiniers (tisseurs à la cave). A cette immense fortune terrienne locale s'ajoutaient d'autres propriétés que les moines possédaient dans les communes environnantes. Dans un inventaire de 1785, on relève le nom de vingt villages où la Prévôté d'Haspres possédait droits et domaines. Domaines vendus, eux aussi, comme Biens Nationaux. |
|
La vente des immeubles des moines : Les moines d'Haspres possédaient en outre de nombreux bâtiments : la Prévôté et ses dépendances, la cense Maugré Bâtie sur 2 hectares et dont le porche d'entrée existe toujours rue de Valenciennes, l'immense ferme Jauray tenant au pont du tordoir (cabinet Santin), le moulin, Fleury, quelques maisons... Le 23 janvier 1793, conformément à la loi sur la vente des Biens Nationaux, la Prévôté d'Haspres est mise en adjudication au district de Valenciennes : "Une maison dite maison du Prévôt avec tous les jardins, cours, basses-cours et autres bois plantés, hautes fûtaies, raspes (?) renfermés par la rivière...; l'église restant à la Commune". Maurice Cacheux d'Haspres en sera momentanément acquéreur pour la somme de 12.200 francs mais, ne pouvant payer, elle sera revendue à un dénommé Joly qui à son tour la revendra à Richard. Elle reviendra ensuite à Jean Louis Bourlet et appartiendra au début du siècle dernier à la famille Boca de Beuvrages. Enfin, en 1861, les Lestoille en deviendront propriétaires et, désormais transformée en ferme, elle sera exploitée pendant plus d'un siècle. Vendu également : la cense Maugré, la ferme Jauray, quelques maisons, une tourelle, le moulin... Les ventes s'échelonnèrent sur plusieurs années. Une partie des bâtiments du moulin fut vendue le 17 Prairial de l'an IV ( 5 juin 1796). Ce fut le meunier, Pierre Lagrue, descendant d'une des grandes familles d'Haspres qui en fit l'acquisition. Il acquit également 7 mencaudées de terres, les dernières sans doute provenant de la prévôté, le tout pour la somme de 600 livres. |
La vente des effets des moines : On appelle "effets" les objets mobiliers de la Prévôté et de l'Eglise (meubles, tableaux, vaiselle, bijoux, voitures...). Le 16 juillet 1791 eut lieu l'inventaire des dits effets. L'original de cet inventaire se trouve aux Archives Départementales du Nord mais il nous est impossible de le reproduire dans son intégralité : huit longues pages dont nous citons quelques passages. Jean Joly, Maire d'Haspres, Remy Langlet, officier municipal, sommes transportés à la cy-devant prévôté d'Haspres pour procéder à l'inventaire des effets. Après avoir levé les scellés apposés par la Municipalité : - Sommes passés dans la chambre du Prévôt où nous avons trouvé une armoire en chêne, un buffet, une table en marbre... - Sommes passés par la chapelle où nous avons trouvé une grande croix en cuivre doré, une chasse de St Hugues en argent garnie de pierreries, une chasse de St Achaire garnie de feuilles d'argent... - Sommes passés dans les cours et remises où nous avons trouvé les ustensiles d'une brasserie, une voiture de poste à 4 roues, un chariot... Tous ces "effets" seront chargés dans deux voitures pour être déposés au directoire du district de Valenciennes. L'adjudication de ces "effets" eut lieu le 23 septembre 1791 devant Me Trainin, administrateur et Joly Maire d'Haspres. L'original de la vente se trouve aux Archives Municipales de la ville, dans un si piteux état qu'il est difficilement lisible. 650 "effets" furent vendus publiquement parmi lesquels, le matériel d'une brasserie que Jérôme Quintaine d'Haspres acquit pour la somme de 1 012 livres. Le montant total de la vente s'éleva à 4 793 livres. Notons pour terminer que "certains objets religieux" ont été transmis aux officiers municipaux d'Haspres pour servir au culte de la Paroisse. |
Le trésor des moines : Les moines possédaient vraisemblablement un trésor : bijoux, pierres précieuses, or... trésor qui n'est nullement mentionné aux Archives Départementales du Nord, ni aux archives de Valenciennes ou Mons. Les "anciens" racontaient que lors de la tourmente révolutionnaire, les moines l'avaient enterré pour éviter de le voir tomber aux mains des Républicains. Réalité ? plutôt légende ! Les trésors des Religieux ont toujours frappé l'imagination. Certains historiens recherchent toujours le Trésor des Templiers. Celui des moines de Jumièges aurait disparu lors du naufrage du "Télémaque" en janvier 1790 dans l'estuaire de la Seine, mais rien n'est prouvé. Le trésor des moines d'Haspres restera sans doute une énigme locale. Les moines ayant refusé de prêter serment à la Constitution Civile du Clergé furent contrains de se retirer de la Prévôté. Ils trouvèrent refuge à l'Abbaye de Vicoigne jusqu'en septembre 1792. Puis, suite à la suppression de toutes les communautés religieuses, ils "essaimèrent". Une page de l'histoire d'Haspres était tournée. Guy Morelle. |
|
Le 9 février 1861, François Lestoille,
cultivateur à Haspres, achète
la Prévôté. On pense que cette branche
picarde des Lestoille descend
du Maître de Poste dont le corps repose à
l'église. On peut lire sur
un mur de l'édifice religieux l'épitaphe suivante
: "CI DEVANT REPOSE LE CORPS DE GUILLAUME DE LESTOILLE VIVANT MAISTRE DE LA POSTE DE CE LIEU DÉCÈDE LE 17 DE MARS 1692 AGE DE 70 ANS. PRIEZ DIEU POUR SON ÂME." Un parchemin de Louvois datant de 1687 ( document précieux que possède M.Paul Lestoille ) mentionne l'attribution du Relais de postes d'Haspres à François de Lestoille suite à la démission de son père Guillaume de Lestoille. La particule "de" a vraisemblablement disparu en 1792, quand les registres d'état-civil sont passés du clergé aux communes. ( Extrait de l'acte de vente de la Prévôté ) le 9 février 1861. Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale Empereur des Français A tous, présents et à venir, salut pardevant Maître Bultot dépositaire des minutes de Maître Dupire décédé et gérant de son étude, ont comparu : 1° Madame Hortense Long propriétaire, demeurant à Beuvrages, veuve de Monsieur Joseph Perdry , 2° Monsieur Henri Lucien Boca et Madame Lucie Perdry demeurant à Valenciennes ( Croix d'Anzin ), 3° Monsieur Alfred Lucien Perdry, célibataire demeurant à Beuvrages, lesquels ont, par le présent acte, déclaré vendre, céder et entièrement abandonner à Monsieur François Lestoile (un seul "L" dans cet acte de vente) et Madame Marie Joseph Gaisse son épouse : Une maison couverte en ardoises, bâtie en pierres de taille, avec étage, écurie, grange, bâtiments en dépendant, étang, puits, abreuvoir, colombier, cour, jardin et verger planté d'arbres fruitiers... dite "la Prévôté d'Haspres" le tout sur une étendue de 2 ha 79 a... ( à cet acte s'ajoutent 2 petites maisons attenant à cette Prévôté ). La présente vente est consentie pour et moyennant le prix principal de 24.000 Francs que lesdits sieur et dame Lestoile ont promis de payer aux vendeurs en 10 ans à dater de ce jour... Capital et intérêts seront effectués en numéraires en l'étude de Maître Dupire 30 rue du Quesnoy à Valenciennes. En 1968, un cultivateur originaire de Villers en Cauchies, M. Flahaut, acheta les bâtiments de la Prévôté qu'il essaie, nous l'avons dit, d'entretenir de son mieux, malgré les dépenses énormes que demande un tel édifice. Joyau historique enchâssé dans les bras de la Selle, la Prévôté est là, telle Notre-Dame dans l'île de la Cité, témoin du passé merveilleux de notre petite commune. |
| LISTE DES PRÉVÔTS. |
|
La Prévôté ayant
été incendiée maintes fois lors des
invasions du Hainaut, de nombreuses archives ont disparu
vraisemblablement brûlées. Aussi est-il impossible
de retrouver les noms des Prévôts
antérieurs au XVIème siècle. On sait cependant que, lorsque Bauduin V accorda en 1176 la charte à la ville d'Haspres, le sieur Simon était à la fois mayeur et prévôt. Lorsque cette charte fut complétée en 1197, un des témoins de la part de l'église se nommait Amand, prévôt d'Haspres ( ce nom se retrouve d'ailleurs en 1221 parmi les témoins de la charte d'Iwuy ). Enfin, dans un document daté de 1231, il est question de Watier d'Haspres, prévôt du monastère. .........................1493 : mort de Dom Bulleux. de 1493 à 1519 : Dom Caulier. de 1519 à 1550 : Dom Gisle Payen. de 1550 à 1593 : Abbé Tacruienne. de 1593 à 1602 : Abbé Guillaume Bosquet. de 1602 à 1622 : Abbé Leblanc. de 1622 à 1626 : François Boucault. de 1626 à 1627 : Jean Dupire. de 1627 à 1644 : Antoine Lemerchier. de 1644 à 1648 : Philibert d'Espinosa. de 1648 à 1668 : François Doucet. de 1674 à 1675 : Baldéric Despierre. de 1675 à 1687 : Antoine Parmentier. de 1687 à 1702 : Jean-Baptiste Fontaine. de 1702 à 1724 : De Cuinghen. de 1724 à 1742 : François de Carondelet. de 1742 à 1754 : Ranulphe Raulin. de 1754 à 1772 : André Lequint. de 1772 à 1776 : Chrisostome Lemerchier. de 1776 à la Révolution (1791) : Ambroise Riche. Tous les textes de cette page, sont tiré du livre "HASPRES et son passé" de Monsieur Guy MORELLE. |